Bibliographie
Recherche bibliographique : Conseils pratiques
La fonction recherche permet de trouver rapidement les noms et titres recherchés. Un rectangle mentionnant "recherche" se trouve en haut de l'écran à droite sur le bandeau noir. Ce rectangle est précédé d'une loupe. Il suffit d'y inscrire l'intitulé de votre recherche, de cliquer la touche "entrée" et les résultats s'affichent instantanément. Les trois "A" de tailles différentes qui se trouvent au-dessus du rectangle permettent de modifier la taille des caractères pour une lecture du site à votre convenance.
Rubrique tenue par Nelly Feuerhahn.
Un point c'est tout. Tomi Ungerer
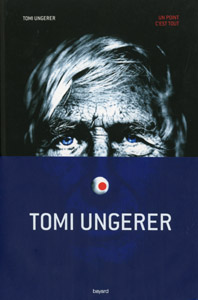
Un point c'est tout. Tomi Ungerer. Entretien avec Stephan Muller. Paris, Bayard, 2011, 190p., 24€.
Mot clé:Tomi Ungerer
A l'occasion de son 80ème anniversaire, Stephan Muller s'est entretenu pendant plusieurs mois avec Tomi Ungerer. Le style oral si vivant, riche d'expressions pittoresques et de jeux de mots se retrouve dans ces pages. Le lecteur suit avec plaisir pas à pas le parcours compliqué d'un artiste qui n'a rien de simple. Le provocateur est aussi un homme engagé dans son temps et critique de tous les conformismes aveugles.
Tomi Ungerer et ses maîtres
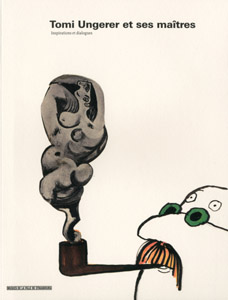
Tomi Ungerer et ses maîtres. Inspirations et dialogues. Catalogue d'exposition au Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'illustration. Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg, 2011, 270p., 34€.
mot clé: Tomi Ungerer
Catalogue de l'exposition du même nom tenue en 2011, cet ouvrage met en regard l'oeuvre du célèbre dessinateur-illustrateur avec l'histoire de l'art, de l'illustration et du cinéma. Trois cents oeuvres recouvrant cinq siècles d'art provenant de collections privées et publiques sont convoquées pour démontrer la richesse du répertoire iconographique dans lequel Tomi Ungerer a puisé. La richesse de l'inspiration de Tomi Ungerer doit beaucoup à la culture de sa famille, de l'Alsace, des liens entretenus par la culture rhénane et germanique.
Tomi Ungerer- Graphic art
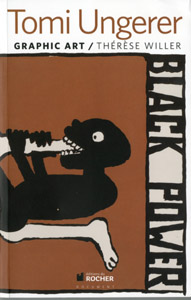 Thérèse Willer, Tomi Ungerer - Graphic art. Paris, éditions du Rocher, 2011, 483 p., 34€.
Thérèse Willer, Tomi Ungerer - Graphic art. Paris, éditions du Rocher, 2011, 483 p., 34€.
Mot clé : Tomi Ungerer
Si Tomi Ungerer est célèbre -et à juste titre- pour son oeuvre de dessinateur et d'illustrateur, il l'est aussi et surtout pour son talent satirique. Il s'adresse tant aux enfants avec des albums illustrés qu'aux adultes avec une diversité étonnante de créations. Avec ce livre, une reprise de sa thèse en histoire de l'art, Thérèse Willer propose un parcours qui éclaire tous les aspects de l'oeuvre d'un créateur qu'elle connaît mieux que quiconque.
Pour les amateurs inconditionnels -et qui ont raison de l'être-, le texte des échanges entre Thérèse Willer et Tomi Ungerer en marge de l'écriture de sa thèse est également disponible :
Tomi Ungerer, Conversation avec Thérèse Willer, Gerpinnes (Belgique), ed. Tandem, 2015, 72p.
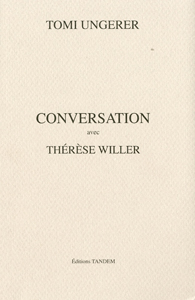
La presse satirique illustrée au XIXème siècle
 Revue Cahiers Daumier, "La presse satirique illustrée au XIXème siècle", n°5, Automne 2011.
Revue Cahiers Daumier, "La presse satirique illustrée au XIXème siècle", n°5, Automne 2011.
Mot clé : Presse satirique, XIXe siècle, Daumier, La Silhouette, Psst...!, Kladderadastch, Presse hongroise, image de la femme, Pologne.
Ce numéro est une source d'apports nouveaux sur la presse satirique dont on ne cesse de découvrir la place exceptionnelle jouée par elle dans la société française et au delà.
Lire la suite : La presse satirique illustrée au XIXème siècle
Un atlas imaginaire
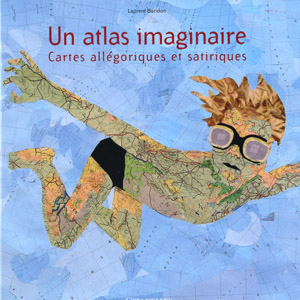 Laurent Baridon, Un atlas imaginaire. Cartes allégoriques et satiriques. Paris, Citadelles & Mazenod, 2011, 240 p., 29x32 cm, environ 100 cartes représentées de tous pays. 69€.
Laurent Baridon, Un atlas imaginaire. Cartes allégoriques et satiriques. Paris, Citadelles & Mazenod, 2011, 240 p., 29x32 cm, environ 100 cartes représentées de tous pays. 69€.
Mot clé : atlas, allégorie, satire politique, bestiaire, anthropomorphisation.
Ce livre présente des documents que l’on peut qualifier des cartes figurales dans le sens où la représentation cartographique est hybridée avec celle de corps humains ou animaux et, plus rarement, de motifs végétaux. Ce procédé relève d’un phénomène que chacun connaît bien. Quiconque a longuement observé les nuages dans le ciel ou rêvé en contemplant les contours des terres sur une mappemonde sait que l’imagination conduit parfois à y percevoir des animaux, des personnages ou des visages. Reconnaître des images familières dans des formes inconnues est un phénomène courant. Il permet de relativiser l’étrangeté d’un objet et de surmonter une partie de l’incompréhension qu’il suscite.
Image : Joao Machado, Map, 2007. Collage, coll. de l'artiste
L'art de la grimace
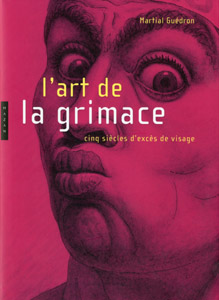 Martial Guédron, L'art de la grimace. Cinq siècles d'excès de visage. Paris, Hazan, 2011, 320 p., 35 euros.
Martial Guédron, L'art de la grimace. Cinq siècles d'excès de visage. Paris, Hazan, 2011, 320 p., 35 euros.
mot clé : grimace, histoire de l'art
Les précédents travaux de l’auteur portaient, d’une part, sur l’image satirique et la caricature, de l’autre, sur les codes et les conventions académiques régissant les représentations de la figure humaine. Or il semble bien qu’il se soit occupé ici de confronter ces deux domaines. Ne serait-ce qu’en feuilletant cet ouvrage abondamment illustré,
A contre-idées

Didier NORDON, À contre-idées. Pour jouer avec les mots...et les idées. Paris, Belin -Pour la science, 20112,,222 pages, 19€.
Mot clé : science
L'ouvrage est un recueil de chroniques parues dans la revue Pour la Science, où Didier Nordon, mathématicien, anime régulièrement la rubrique du Bloc-notes, avec des illustrations du dessinateur Matyo.
"Il n'existe guère de texte, si ennuyeux soit-il, qui ne contienne une perle susceptible de faire rire." affirme Didier Nordon et il s'avère à la lecture de ses différents livres que rien n'y n'infirme le propos.
Les revues satiriques françaises
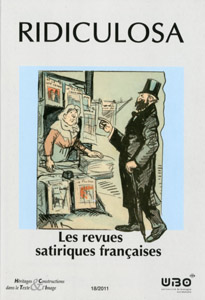
Revue Ridiculosa, "Les revues satiriques françaises", n°18, 2011. 368 p., 15 euros.
Textes réunis par Jean-Claude Gardes, Jacky Houdré et Alban Poirier.
Mot clé : presse satirique, caricature
Longtemps laissée pour quantité négligeable, la presse satirique connaît depuis quelques années un intérêt soutenu de la part de chercheurs de différentes disciplines. Après le travail considérable du Dico Solo (1996/2004), il est utile que les productions humoristiques et satiriques trouvent des lieux d'analyse à la disposition des chercheurs.
Les succursales du rire
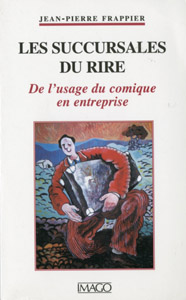
Jean-Pierre Frappier, Les succursales du rire. De l'usage du comique en entreprise. Paris, Imago, 1999, 194p.
Mot clé : Entreprise, clown
Approche sociologique, l'ouvrage publié en 1999 analyse le fonctionnement du rire dans le management des entreprises. A partir d'exemples précis, la critique s'avère radicale et les tenants du rire sans limite priés de revoir leur copie. Le théâtre comique d'entreprise, contrôlé par la direction, ne peut se soustraire à son autorité. Le rire devient un moyen de manipuler le personnel comme le montre très bien ce travail.
Humour et crises sociales
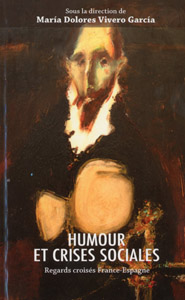 Maria Dolores Vivero Garcia (dir.), Humour et crises sociales. regards croisés France-Espagne. Paris, L'Harmattan, 2011, 214 p. 20,50 euros.
Maria Dolores Vivero Garcia (dir.), Humour et crises sociales. regards croisés France-Espagne. Paris, L'Harmattan, 2011, 214 p. 20,50 euros.Mot clé : Etude contrastive, Espagne, France, presse, Libération, littérature contemporaine, ironie
Humour et mise en cause de la doxa en temps de conflit ou de crise. Cet excellent ouvrage propose une approche des catégories conceptuelles pour l’étude contrastive (français-espagnol) de l’humour et de l'ironie dans la presse et dans la littérature contemporaine.
L’humour est une des stratégies discursives qui révèle le mieux le type de relation à l’œuvre entre les membres d’un groupe social ainsi que l’identité culturelle qui leur est propre. C’est donc un domaine privilégié pour l’étude des différences et des ressemblances entre les cultures européennes. Bibliographie
Bibliographie